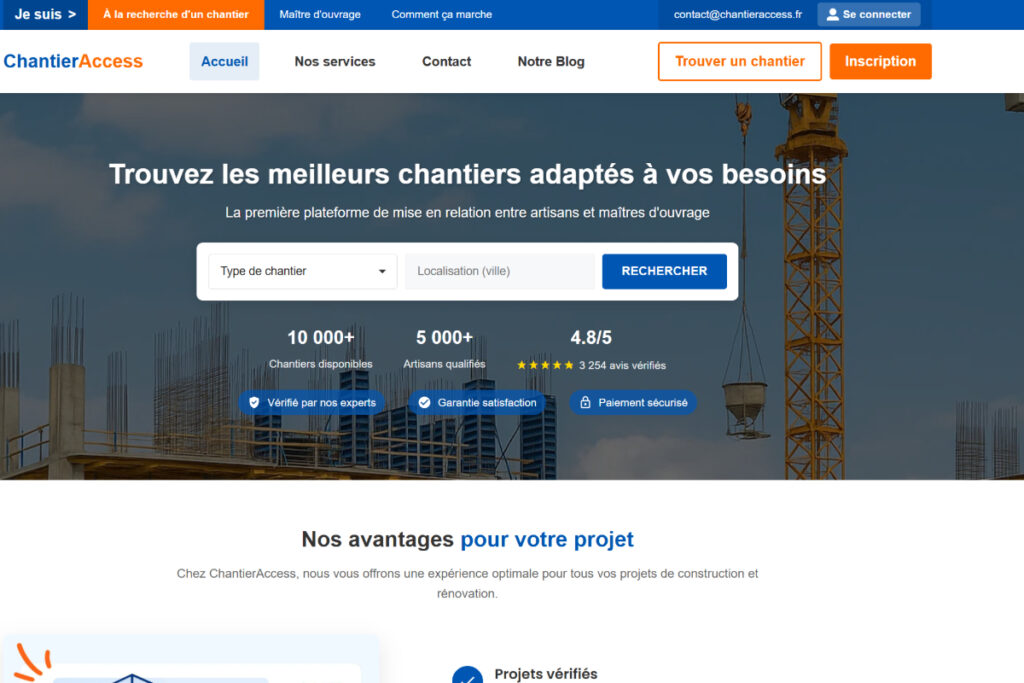Qui doit faire la recherche de fuite en copropriété ?
Une tache humide vient d’apparaître au plafond ou une odeur de moisi flotte dans la cage d’escalier ? Vous vous demandez aussitôt : qui doit lancer la recherche de fuite et payer l’expert ? Avant de vous noyer dans les démarches, profitez de ce bref récapitulatif 👇 Scénario Qui contacte le professionnel ? Qui règle la facture ? Assurance mobilisée Fuite dans votre logement (vous êtes locataire) Vous Vous avancez, puis remboursement Multirisque habitation du locataire Fuite dans votre logement (vous êtes copropriétaire occupant) Vous Vous ou votre assureur MRH du copropriétaire occupant Fuite dans votre logement vacant ou loué Propriétaire bailleur Bailleur Assurance PNO Fuite dans les parties communes Syndic Copropriété Assurance immeuble Origine incertaine ou accès impossible Syndic (coordonne) Avance par l’initiateur, partage ensuite Assureur gestionnaire selon convention IRSI Gardez ce tableau sous le coude : il résume l’essentiel. Passons maintenant aux détails pour que vous sachiez exactement comment réagir, qui appeler et à quoi vous attendre côté budget 💧. Pourquoi réagir dès la première goutte Une fuite qui traîne, ce n’est pas qu’une trace disgracieuse. En quelques jours, l’eau peut fragiliser un plancher, provoquer des courts-circuits ou faire grimper votre facture d’énergie. Sans réaction rapide, les frais de remise en état doublent, les tensions montent entre voisins et les assureurs lèvent un sourcil : « Pourquoi si tard ? » Mieux vaut agir tout de suite : vous réduisez les dégâts, les coûts et les discussions sans fin. Les acteurs clés et leurs rôles Dans une copropriété, plusieurs chapeaux se croisent. Comprendre qui fait quoi vous épargne bien des appels inutiles : Vous, occupant des lieux Locataire ou copropriétaire occupant, vous vivez sur place. C’est donc vous qui constatez la fuite en premier. Votre mission : couper l’eau si possible, prévenir vos voisins immédiats et déclarer le sinistre à votre assurance dans les 5 jours ouvrés. ⚠️ Dépasser ce délai complique les remboursements. Le propriétaire bailleur Même s’il n’habite pas sur place, le bailleur doit entretenir le logement loué. Si le locataire est absent ou non assuré, le propriétaire prend le relais, active son assurance PNO et organise la recherche de fuite. Le syndic Gardien des parties communes, il déclenche l’intervention quand la colonne montante fuit, quand le plafond du hall goutte ou tout simplement quand l’origine reste floue. Il coordonne aussi l’accès aux logements récalcitrants grâce à la nouvelle procédure judiciaire qui permet d’ouvrir une porte sous contrôle d’huissier. Partie commune ou privative ? La question à 1 000 € Avant même d’appeler un plombier, sachez où court votre canalisation : 🛠️ Canalisation branchée sur un compteur individuel : partie privative, charge au copropriétaire. 🏢 Tuyau traversant plusieurs lots ou encastré dans une gaine verticale : partie commune, donc syndic. Vérifiez votre règlement de copropriété : il tranche les cas limites et évite les disputes de palier. En cas de doute persistant, le rapport du professionnel fera foi. Assurance et convention IRSI : votre boussole financière Depuis 2018, la convention IRSI (Indemnisation et Recours des Sinistres Immeuble) simplifie la prise en charge des dégâts des eaux jusqu’à 5 000 € hors taxes. Trois points clés : Un seul assureur est nommé gestionnaire ; il avance les frais et se débrouille ensuite avec les autres compagnies. La recherche de fuite est payée par l’assureur du local où l’expert intervient. Exemple : fuite dans votre salle de bain => votre MRH. Pas de franchise ni de plafond pour la recherche de fuite : vous n’avez pas à négocier le coût de l’investigation, seulement à fournir la facture. Étapes concrètes pour lancer la recherche de fuite 🎯 Suivez ce parcours : Constater : photo, vidéo, date et heure. Sécuriser : couper l’eau ou l’électricité si nécessaire. Informer : voisins, syndic, propriétaire, selon votre cas. Déclarer : votre assurance sous 5 jours. Missionner le pro : plombier ou société spécialisée. Transmettre le rapport : à l’assureur gestionnaire. Programmer la réparation : souvent rapide une fois la fuite localisée. Techniques modernes pour débusquer une fuite sans casser partout Fini le marteau-piqueur systématique ! Les professionnels disposent d’outils high-tech : 🔍 Caméra thermique : révèle la différence de température créée par l’eau. 🎧 Détecteur acoustique : écoute le sifflement de l’eau sous pression. 🔬 Gaz traceur : un gaz inoffensif injecté dans la canalisation s’échappe au point de fuite, visible au détecteur. 🟢 Colorant fluorescent : idéal pour les réseaux complexes. 📸 Caméra endoscopique : inspecte visuellement l’intérieur d’un tube. Ces méthodes limitent la casse, réduisent la durée du chantier et rassurent les copropriétaires qui redoutent la poussière. Combien ça coûte et qui rembourse ? En 2025, une recherche de fuite non destructive coûte en moyenne 250 € à 450 € en appartement. Les investigations plus poussées (gaz traceur, caméra infrarouge longue distance) grimpent jusqu’à 850 €. Le professionnel facture directement le demandeur, qui transmet ensuite la note à son assureur. Avec la convention IRSI, la majorité des contrats remboursent à 100 % sans franchise. Pour une étude plus approfondie concernant le tarif d’une recherche de fuite, vous pouvez consulter cette source. 💡 Pensez à demander un devis : votre assurance l’exige souvent avant validation. Éviter la prochaine inondation : les bons réflexes Une fois la fuite colmatée, reste à prévenir la suivante : 📅 Entretien annuel des chauffe-eau, soupapes et joints. 🚪 Accès facile aux vannes d’arrêt dans chaque lot. 💧 Sonde connectée sous l’évier : elle coupe l’eau en cas de goutte détectée. 📝 Point fuite à chaque assemblée générale du syndicat pour planifier le remplacement des colonnes vétustes. FAQ express Que faire si le voisin au-dessus refuse d’ouvrir sa porte ? Prévenez le syndic. Il peut solliciter le juge des référés : depuis 2024, une ordonnance permet l’accès forcé avec un huissier lorsqu’un dégât des eaux menace le bâtiment. Dois-je payer une franchise ? Dans la plupart des contrats, aucune franchise ne s’applique à la recherche de fuite. Vérifiez toutefois votre police : certains assureurs exigent un reste à charge symbolique. Et si la cause vient d’une toiture commune ? Le syndic gère la recherche et les travaux. Les frais se répartissent selon les tantièmes de chacun, sauf clause spéciale dans votre règlement. Gardons les pieds au sec ! Une fuite d’eau ne se choisit pas, mais vous savez